Les IAG dans l'enseignement supérieur et la recherche : entre dilemme moral et question sociale
L'introduction des intelligences artificielles génératives dans l'enseignement supérieur constitue un véritable point de bascule qui ébranle les fondements traditionnels de la déontologie universitaire. Cette transformation majeure interroge trois piliers essentiels de l'écosystème académique : l'intégrité scientifique, l'authenticité et l'autonomie intellectuelle. L'expérience récente de la start-up Sakana, dont le système d'IA a produit un article scientifique complet sans intervention humaine directe et réussi l'évaluation par les pairs, illustre parfaitement ce trouble dans l'auctorialité qui traverse désormais l'ensemble du champ académique. Face à ces technologies, les repères normatifs traditionnels perdent leur force prescriptive. L'intégrité académique se trouve mise à l'épreuve par l'impossibilité pratique de distinguer clairement entre usage passif et actif des IAG, rendant obsolètes les notions classiques de plagiat et de triche. Un texte peut désormais être formellement original tout en étant frauduleux, car non authentiquement produit par son auteur déclaré. Cette ambiguïté révèle que le problème excède la simple opposition entre bon et mauvais usage pour interroger la nature même de l'effort intellectuel légitime. L'enjeu de l'authenticité prend alors une dimension nouvelle. Dans un monde où l’enseignement et la recherche sont produits en collaboration avec des machines d’écriture, émerge une subjectivité hybride comparable à la figure du cyborg de Donna Haraway. Cette nouvelle forme d'authenticité ne réside plus dans une origine pure du texte, mais dans la capacité à comprendre et façonner les mécanismes d'écriture partagés entre humain et machine.
Les IAG fonctionnent comme des co-auteurs implicites qui orientent subtilement les formes de pensée, soulevant la question fondamentale de ce qui constitue l'expression authentique de soi dans ce contexte technologique. L'autonomie, pilier éthique de l'enseignement supérieur, se trouve également redéfinie. Aylsworth et Castro (2024) proposent une éthique du non-usage fondée sur l'obligation morale de cultiver sa propre capacité de réflexion et de jugement. Pour eux, déléguer l'écriture à une IA revient à renoncer aux facultés mêmes qui rendent l'autonomie possible. Mais il existe une tension entre autonomie comme fin éducative et autonomie comme liberté de choix, qui résume le dilemme contemporain face aux IAG. Mais cette tension pose aussi la question de savoir « qui dispose réellement de la liberté de choisir de ne pas les utiliser ? ». Car cette liberté du non-usage devient elle-même un privilège social, dévoilant que derrière l'apparente égalisation des performances se cache une inégalité structurelle plus profonde. Les IAG véhiculent un habitus dominant reflétant les normes linguistiques des groupes sociaux favorisés. Tandis qu'elles semblent uniformiser l'accès aux compétences d'écriture, elles renforcent en réalité les hiérarchies existantes.
A partir des résultats d’une enquête auprès des étudiants, je montrerai que les étudiants disposant d'un fort capital culturel perçoivent ces outils comme utilitaires et limitatifs, tandis que ceux moins dotés culturellement les utilisent pour accéder à un langage symboliquement valorisé, risquant de se placer en situation d'imposture culturelle. Cette dynamique pourrait accentuer les inégalités académiques : alors que les élites se reconvertissent vers des compétences que l'IA ne maîtrise pas encore, comme la pensée critique ou investisse davantage dans l’oralité, les plus précaires deviennent dépendants de ces technologies. Ainsi, les IAG redessine les contours du pouvoir académique et questionne les modalités futures de l'égalité des chances dans l'enseignement supérieur.

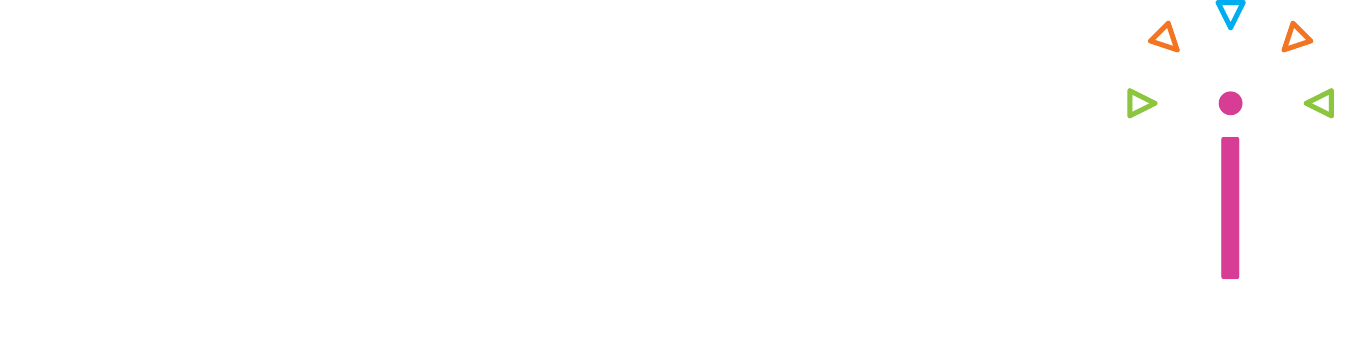




![[🗣️ SÉMINAIRE] IntheArt - Bilel Benbouzid, Université Gustave Eiffel](/sites/default/files/2025-09/CEA_Coscinus_DataIA_logo_v2.png)