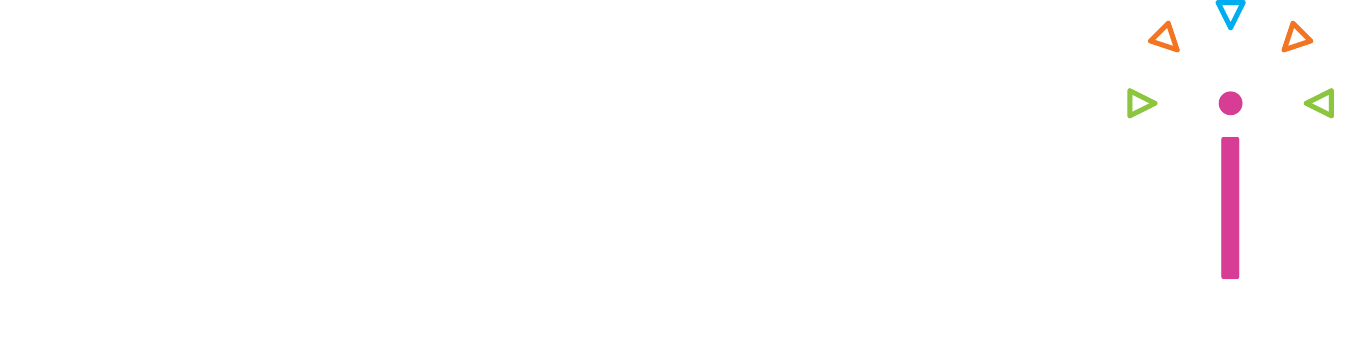Dans les relations entre mathématiques et intelligence artificielle (IA), l’idée que la seconde peut aider à résoudre des problèmes des premières est souvent la plus visible, comme le montrent les attributions de médaille d’or aux IA lors des Olympiades internationales de mathématiques. Mais l’inverse est vrai aussi : les maths peuvent aider les IA. Après tout, ce n’est que justice, car ces dernières sont bâties avec des outils et méthodes venus de ce champ, notamment les statistiques.
Et cette branche est toujours très vivace. « Au début, quand nous avons vu arriver les méthodes d’IA appliquées à nos domaines, comme l’imagerie médicale, on pensait que nous n’aurions plus rien à faire. Il y a eu des moments de doute, se souvient Emilie Chouzenoux, directrice de recherche à l’Inria Saclay et membre du Centre de vision numérique, spécialiste de méthodes d’optimisation et du traitement des images. Mais on a vite compris qu’on avait toujours besoin de maths ! »
La liste est longue de ce que la discipline peut apporter aux IA. D’abord comprendre leur fonctionnement ou quantifier les incertitudes de leurs réponses, ou bien optimiser leur entraînement, ou encore les rendre plus fiables en « débiaisant » leurs résultats, ou plus frugales, en diminuant les temps de calcul et les consommations électriques. Elles aident aussi à démêler les corrélations permettant d’identifier les causes et les effets…
« On ne peut pas tout lister, sans crainte de vexer certains », s’amuse Marianne Clausel, professeure à l’université de Lorraine, spécialiste de l’apprentissage statistique, la grande famille à laquelle appartiennent les chatbots à succès. Avec sa collègue, elle a lancé, depuis fin 2023, une série de conférences trimestrielles pour échanger en France sur ces questions de mathématiques et d’IA. L’objectif est surtout de « rassembler une communauté diverse et dispersée » et de « rendre visible ce thème auprès des jeunes ». La prochaine sera sur les maths des IA génératives.
« On ne peut pas se passer des maths. Elles répondent au pourquoi, elles identifient les facteurs-clés de la performance », précise Marianne Clausel. C’est la solution pour ce qu’il est convenu d’appeler l’« IA de confiance », garantissant les résultats, assurant leur résistance aux « attaques » ou perturbations, promettant l’explicabilité des conclusions…
Apports fructueux
« Cette communauté qui étudie l’IA n’aime pas les boîtes noires et veut soulever le capot », complète Emilie Chouzenoux. Outre les conférences qu’elles organisent, elles participent, avec de nombreux autres spécialistes, au volet maths du Programme et équipement prioritaire de recherche IA, financé par France 2030 depuis 2024 pour 73 millions d’euros sur six ans. Ou à l’IA Cluster, lancé en 2023, pour 500 millions d’euros.
Les exemples d’apports fructueux sont déjà nombreux. L’une des vedettes de cette branche est Stéphane Mallat, professeur au Collège de France et médaille d’or 2025 du CNRS, qui, depuis son retour à la vie académique après une expérience dans une start-up d’imagerie, tente d’« entrer à l’intérieur des IA », comme il l’a expliqué dans sa conférence au colloque de rentrée du Collège de France, le 16 octobre. Il a ainsi contribué à montrer des analogies entre l’architecture de certains réseaux de neurones et le cortex visuel.
Il a aussi montré comment ces IA « capturent » des lois de la physique et de la chimie, sans que les chercheurs leur fournissent les équations. « Les IA ne sont pas des perroquets stochastiques », a-t-il déclaré en conclusion de sa conférence, en faisant allusion à une célèbre critique des IA selon laquelle elles ne sont capables que de recracher des textes ou images déjà vus. « Elles apprennent des connaissances sophistiquées », précise-t-il.
Emilie Chouzenoux a, quant à elle, montré comment modifier des méthodes d’apprentissage en imagerie pour éviter que des systèmes fonctionnant pour les données d’un hôpital ne marchent plus sur celles d’un autre, comme cela avait été constaté avec des IA standards. Marianne Clausel a breveté une méthode permettant d’évaluer l’état de santé des batteries industrielles à partir de mesures de leurs cycles de charge et décharge, avec l’estimation de la marge d’incertitude.
Les deux chercheuses citent aussi les travaux d’un de leurs collègues, Gabriel Peyré, ancien thésard de Stéphane Mallat, qui utilise des outils d’un domaine fondamental des maths, le transport optimal, en génomique ou en neurosciences. Le transport optimal permet aussi de « débiaiser » des résultats en déplaçant les distributions de probabilité pour rééquilibrer les résultats. Il est en effet établi que les IA reproduisent les biais présents dans leurs données, comme le genre, l’origine géographique… Le mathématicien Cédric Villani avait reçu la médaille Fields en 2010 dans ce domaine du transport optimal. En revanche, les deux chercheuses n’utilisent guère les chatbots les plus populaires dans leur quotidien. « Sans doute qu’en étant du domaine on mythifie moins ces outils que nos collègues ! »