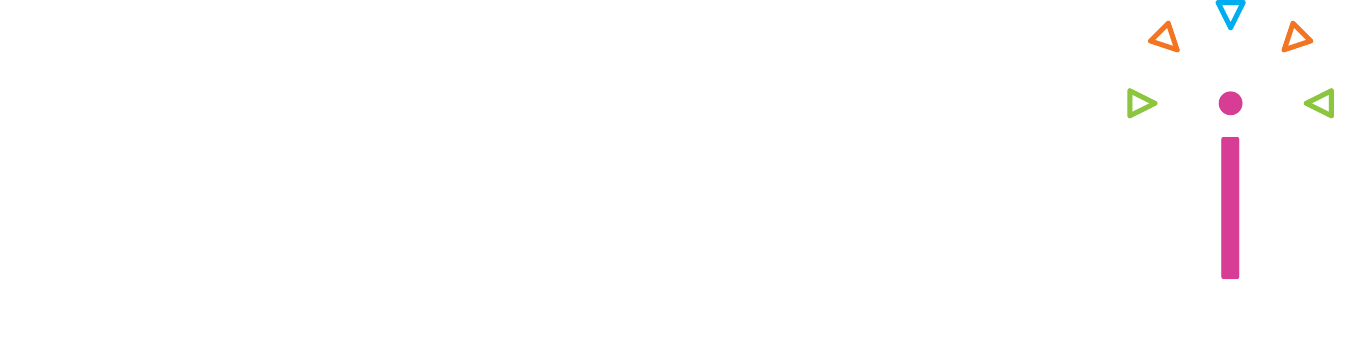« Le mémoire est mort, vive le mémoire ? » Fin février, c’est par cette formule que Vincent Salaun, maître de conférences à l’Institut d’administration des entreprises (IAE) de l’université de Bretagne occidentale de Brest, a annoncé en finir avec le traditionnel mémoire universitaire dans le master qu’il dirige. Les étudiants du master 2 « Management des systèmes d’information » verront ce totem de l’enseignement supérieur remplacé, dès juin, par un « grand oral » d’une heure sur le sujet de leur choix.
Celui-ci sera simplement accompagné d’un dossier à rendre dans lequel les étudiants analyseront les compétences acquises durant leur formation. Terminée la centaine de pages censées montrer les capacités de recherche, de synthèse, d’analyse et de rédaction des étudiants ! ChatGPT, Gemini et autre Copilot en ont eu raison.
« Quel sens ont encore les travaux écrits individuels réalisés à la maison, comme ce rite initiatique du mémoire universitaire ? Faut-il les modifier ou les remplacer ? Par quoi ? », résume l’enseignant-chercheur. Passé la période de sidération engendrée par l’arrivée en grande pompe des intelligences artificielles (IA) génératives dans le grand public, fin 2022, les enseignants du supérieur ont peu à peu vu, avec crainte, les outils d’IA prendre place dans les pratiques des étudiants. Une révolution à même de chambouler à la fois l’authenticité des copies, la nature des examens et la valeur des diplômes…
Trois ans après, « la question n’est plus de savoir s’il faut s’opposer aux IA, mais comment on va vivre avec ces outils que les étudiants utilisent dorénavant massivement », commente Vincent Salaun, dont le master sert de « pilote » à l’IAE de Brest pour tester ces nouvelles modalités d’examen, avant une possible généralisation. « La grande majorité de nos élèves utilisent les IA, constate également Sarah Cohen-Boulakia, directrice adjointe de l’Institut DataIA de l’université Paris-Saclay. Ce sont des outils efficaces pour des exercices de reformulation, de simplification et de traduction. »
Revoir les évaluations
Les étudiants ont à leur portée une ressource qui va gommer certaines de leurs faiblesses académiques, en renforcer d’autres, et ils ne s’en privent pas. « C’est un instrument pédagogique qui permet de lire énormément et de résumer, de gérer des fichiers Excel fastidieux, d’écrire des lignes de code dans presque tous les langages informatiques, c’est un puissant soutien », poursuit Cyprien Plane, président du Bureau national des élèves ingénieurs. Quant aux contrôles auxquels doivent se soumettre les élèves pour évaluer leur progression, « ils sont caducs, rend compte le représentant étudiant. L’IA est beaucoup plus puissante que la plus sophistiquée des antisèches ». Il faut donc revoir les évaluations.
Plus de 80 % des jeunes de 18 à 21 ans auraient recours aux IA génératives dans le cadre de leurs études, selon un rapport sénatorial d’octobre 2024, citant diverses études sur le sujet. A titre de comparaison, ils étaient « seulement » 55 % à les utiliser régulièrement en 2023, selon un sondage de l’institut Le Sphinx pour le logiciel Compilatio, spécialisé dans la prévention de la fraude académique.
Cet acteur privé bien connu des professeurs a rapidement proposé ses services de détection de l’utilisation des IA par les étudiants dans leurs travaux. Le premier réflexe de nombreux enseignants a en effet d’abord été de traquer la « triche », comme ils avaient l’habitude de le faire avec le plagiat traditionnel. Avant de se rendre à l’évidence : ces outils, qui donnent en général une estimation du pourcentage de texte potentiellement généré par IA, « sont incapables de repérer parfaitement l’utilisation de l’IA générative pour tricher », tranchait, fin février, la Conférence des grandes écoles dans un Livre blanc numérique.
En cause, le risque de « faux positif » lorsque ces outils reconnaissent le style et les tournures d’un texte généré par l’IA, alors que l’étudiant l’a « seulement » utilisé pour réviser, reformuler ou corriger grammaticalement sa production. « Un élève qui sait bien prompter [écrire la requête permettant de générer des textes ou des images] peut, par ailleurs, contourner facilement ces détecteurs. Sans parler des logiciels spécifiquement conçus pour les tromper », commente Alain Goudey, directeur général adjoint chargé du numérique chez Neoma Business School.
Selon ce spécialiste des IA dans l’enseignement supérieur, « c’est une bonne chose si les détecteurs ne marchent pas, car cela oblige les établissements et les enseignants à renouveler leurs modalités d’évaluation à la hauteur de l’enjeu ». Pour l’heure, les écoles en sont encore à un stade de « tâtonnement général », selon la Conférence des grandes écoles. La situation est similaire dans les universités, qui se dotent une à une, depuis quelques mois, de chartes encadrant l’utilisation des IA.
« Il ne faut surtout pas interdire »
Pour s’assurer de l’authenticité des productions des étudiants, la première réaction, en France comme à l’étranger, a été de renforcer les examens traditionnels avec papier et crayon au sein même des formations, les devoirs sur table. Mais, à Neoma, une école qui se veut précurseur dans l’usage des nouveaux outils numériques, et où « près de 90 % » des enseignants ont été formés à l’IA, les étudiants sont par défaut autorisés à l’utiliser, à condition d’être honnêtes et transparents sur cette utilisation. « Dans ce cas-là, on attend d’eux qu’ils aillent beaucoup plus loin dans la réflexion et la production, tant en termes qualitatifs que quantitatifs », commente Alain Goudey.
Dans les examens, la place et le poids des oraux ont aussi été renforcés. « Ces échanges oraux formalisés avec l’étudiant, sous forme de questions-réponses, sont aussi un bon moyen de s’assurer qu’il maîtrise un sujet, les connaissances et compétences qui vont avec… », explique Loïc Plé, directeur de la pédagogie à l’Iéseg. Dans cette école de management, les modalités d’évaluation de tous les programmes ont été passées en revue afin de vérifier là où des évolutions étaient nécessaires face aux IA. Outre les devoirs sur table, les présentations orales, les « feed-back beaucoup plus réguliers et détaillés » pour les devoirs à la maison, le simple fait de complexifier ou, à l’inverse, de simplifier, les énoncés d’exercice peut suffire à rendre l’usage des IA plus difficile pour les étudiants.
« Est-ce que toutes nos évaluations sont désormais “IAG proof” [étanches aux IA génératives] ?, interroge en souriant Loïc Plé. La réponse est non, mais c’est un choix. Car nous souhaitons aussi évaluer la capacité de nos étudiants à savoir utiliser ces IA. ». Les principaux intéressés ne comprendraient d’ailleurs plus une interdiction pure et simple. « Les entreprises qui vont nousembaucher attendent de nous que nous maîtrisions les outils. Il ne faut surtout pas interdire, mais donner un cadre », rappelle ainsi Cyprien Plane.
« Eveiller l’esprit critique »
Des enseignants racontent leurs tentatives pour intégrer cette nouvelle technologie dans leurs évaluations. Ici, un examen « ouvert » où les IA sont totalement autorisées, mais où les étudiants doivent rendre compte de leurs prompts. Là, une épreuve où les étudiants sont invités à évaluer la qualité d’une réponse générée par une IA en faisant appel à leurs connaissances… « L’idée est de plus en plus de faire de cette IA un objet pédagogique à part entière, de l’utiliser pour éveiller l’esprit critique des étudiants, dans des évaluations formatives et pas seulement sommatives », résume Pierre Beust, directeur du service d’appui à la pédagogie de l’université de Rennes, un établissement particulièrement avancé sur ces sujets.
« Nous vivons un moment de bascule. Nous sommes passés en quelques décennies de la machine à écrire au traitement de texte et aujourd’hui à la génération de texte. Utilisons les IA, questionnons-les ! », observe Jacques Fayolle, directeur de l’Ecole des mines de Saint-Etienne et membre de la commission permanente de la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs. Selon lui, à l’avenir, avec l’avènement des IA, les évaluations ne se feront de toute façon plus sur les connaissances mais sur des mises en situation, elles tendront vers un apprentissage par problème et conduiront les étudiants à détailler les étapes et ressources nécessaires à sa résolution.
Il reste à convaincre tous les enseignants. Or, comme à chaque bouleversement technologique, « il y a les primo-adoptants, le ventre mou et, enfin, les rétifs, observe Jacques Fayolle. C’est le ventre mou qu’il faut convaincre et faire évoluer ». D’où les programmes de sensibilisation ou, mieux, de formation des enseignants aux IA, désormais proposés dans les établissements. Un apprentissage d’autant plus nécessaire que, si les étudiants peuvent utiliser les IA, celles-ci sont aussi un accélérateur et un facilitateur pour les enseignants, qui peuvent s’en servir pour produire des cours et des examens. « L’IA peut générer des questions pertinentes. Elle peut également corriger les évaluations et l’avancée des compétences acquises dans un niveau de détail qu’un professeur seul aurait du mal à atteindre », souligne Frédéric Pascal, professeur de mathématiques appliquées à CentraleSupélec.
Par ailleurs directeur de l’Institut DataIA, il porte, depuis décembre 2024, une mission sur l’IA dans les pratiques pédagogiques du supérieur avec François Taddei, président du Learning Planet Institute. Pour éclairer le gouvernement, mais aussi les établissements et les enseignants, sur cette révolution qui ne fait que commencer, leurs propositions devraient intervenir avant l’été.
Par Séverin Graveleau et Eric Nunès