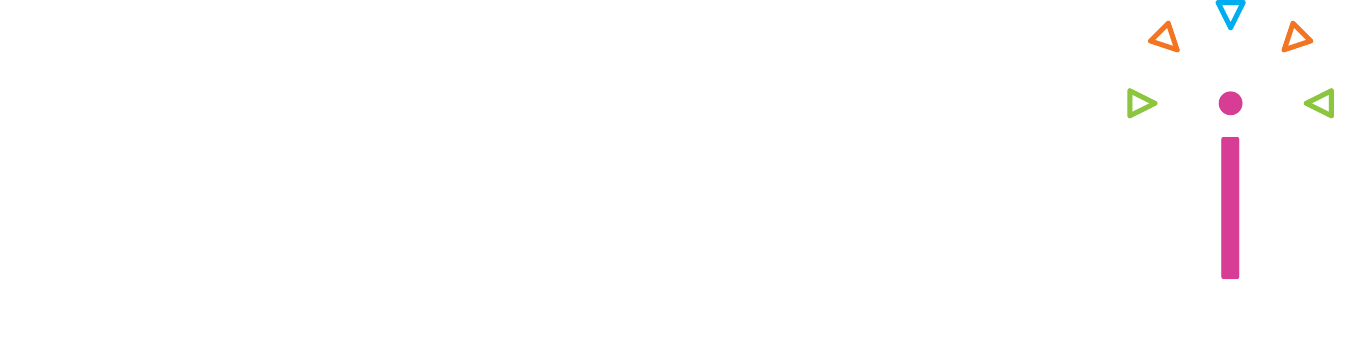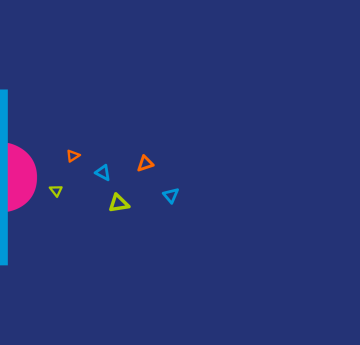Si vous souhaitez introduire des outils IA dans vos formations,
nous vous invitons à compléter le formulaire dédié !
Généralités sur le SPOC BrevetAI
-
Qu’est-ce que signifie un SPOC ?
Small Private Online Course (cours en ligne). C’est équivalent à un MOOC mais dédié aux étudiants inscrits dans notre université (au sens le plus large, incluant composantes, écoles et université membre-associées).
-
Est-ce que le SPOC BrevetAI est déjà disponible ?
Depuis avril 2025, l’intégralité du BrevetAI est disponible sur eCampus en bêta testing. Il sera déployé plus largement à la rentrée 2025-2026.
-
Existe-t-il en anglais ?
Pour le moment, il n’y a que les vidéos qui sont sous-titrées en anglais.
-
Pourquoi s’appelle-t-il BrevetAI et non BrevetIA ?
Ce n’est pas du tout pour faire un anglicisme, mais parce qu’il a été développé dans le cadre du projet SaclAI School (jeu de mots avec SaclAY->SaclAI).
Public cible, pré-requis et accessibilité
-
À qui est destiné le BrevetAI ? Est-il accessible aux étudiant(e)s qui n’ont jamais touché à l’informatique ?
BrevetAI est accessible à tous les étudiants dès la L1, quel que soit leur profil ou leur parcours. BrevetAI propose deux formules :
Un parcours découverte d’environ 10 heures pour une première approche. Un parcours avancé d’environ 20 heures pour aller plus loin.
-
Il y a-t-il des prérequis pour ces SPOC ?
Il n’y a aucun prérequis. Le SPOC a même été testé avec des élèves de terminale, donc il est accessible dès la L1, quelque soit la filière.
-
Est-ce que le SPOC BrevetAI peut être suivi par le corps enseignant ou autre personnel également pour leur propre formation ?
Oui, tout à fait. Il suffit de faire une demande d’inscription afin que nous puissions ouvrir un compte d’accès.
Pour tester la plateforme, rendez-vous sur : https://ecampus.paris-saclay.fr/course/view.php?id=135568.
Clef : dVUfsKGE
> Choisissez l’option Auto-inscription (Enseignant·e, Responsable de formation, Personnel...)
> Si vous faites le test, pensez à remplir les Framaforms de feedback, disponibles sur eCampus.
Contenu, structure et planification des cours
-
Est-il possible d'avoir le plan détaillé avec les contenus abordés dans BrevetAI ? Quelles sont les compétences abordées ?
Le plan détaillé des cours est disponible sur le site internet de l’Institut DataIA, à l’adresse suivante : https://www.dataia.eu/formations/acculturation-lia-brevetai. Des objectifs pédagogiques et des compétences sont associés à chaque formule.
-
Les deux niveaux de formation – Découverte et Avancé – sont-ils indépendants et sécables ?
Oui, les deux niveaux peuvent être suivis séparément. Le niveau « Avancé » inclut le contenu du niveau « Découverte ». Un étudiant qui suit les deux niveaux repassera donc la première partie, ce qui est surtout utile s’il y a un décalage d’une année (ex : L2 puis L3). Il est déconseillé de proposer les deux niveaux simultanément au même groupe.
-
Quelle granularité est possible pour la planification ?
Il est préférable de raisonner à l’échelle du semestre ou du demi-semestre. Une fois la session lancée, les étudiants forment une cohorte identifiée, avec un début et une fin. Les résultats sont transmis à la fin sur eCampus.
-
Peut-on intégrer le SPOC BrevetAI dans les maquettes pédagogiques librement ? À quelle période de l’année est-il disponible ?
Oui, vous êtes libres de positionner le SPOC dans vos maquettes au semestre ou à la période de votre choix. Le BrevetAI est disponible de manière flexible toute l’année, sans contrainte extérieure de calendrier imposée. Par contre tous les étudiants d’une même formation débuteront et termineront le Brevet de façon synchrone.
Évaluation et certification
-
Il y a-t-il une évaluation à la fin du cours avec une note concrète ?
Oui, une évaluation est proposée à chaque partie. La note finale est composée du résultat obtenue aux différents quiz mais aussi à la capacité de l’étudiant.e à réussir les activités interactives de type résolution de problème qui lui ont été proposé. Il est à noter que concernant le cours sur les enjeux sociétaux, le format des évaluations est différent : Pour chaque partie, les étudiants seront amenés à tester leurs connaissances sur des mises en situation fictives en répondant à un quiz. L’objectif est de mobiliser ce qu’ils ont appris dans des situations proches de la réalité.
-
En cas d’échecs répétés, l’étudiant(e) est-il pénalisé(e) dans sa note ?
Une évaluation est proposée à chaque partie, composée de quiz et d'activités sous la forme de résolution de problèmes.
Les activités ont des essais illimités, l’étudiant doit réussir l’activité pour valider cette partie de l’évaluation.Les activités comptent pour 8 points sur une note finale de 20. Les quiz ont des essais limités (3), l’étudiant doit obtenir au moins 50% de réponses correctes pour valider cette partie de l’évaluation. Les quiz comptent pour 12 points sur une note finale de 20. Le système vise à ne pas bloquer l’étudiant(e). En cas d’échec, ils peuvent tout de même continuer le cours.
-
Si un(e) étudiant(e) est bloqué(e) sur un exercice, est-il-elle aidé(e) pour poursuivre ? Est-ce que cette aide est accessible en continu ?
Oui, en cas de blocage, des indices sont donnés, puis un déblocage et un débrief sont proposés. La mascotte de BrevetAI fournit des indices progressifs. Après plusieurs échecs, l’étudiant.e est aidé pour avancer.
-
Quelle est la différence entre avoir une note et avoir une micro-certification ? Est-ce deux choses différentes ?
Le BrevetAI délivre une note permettant de valider des ECTS quand il est intégré dans la maquette d’une formation. Parallèlement, il y a une micro-certification avec un badge attestant des compétences. Pour les étudiant.es qui souhaiteraient suivre le BrevetAI alors qu’il n’est pas proposé dans la maquette de formation, ils ou elles peuvent le faire. Dans ce cas, aucune note n’est fournie c’est la micro-certification qui est obtenue et reste un complément valorisable.
-
La micro-certification est-elle obtenue à l'issue des 2 modules où après chaque module ?
Pour chaque formule (formule 1 avec 2 cours, formule 2 avec 4 cours), il y a une micro-certification distincte. En tout, deux micro-certifications sont délivrées, associées à des compétences différentes. La formule avancée comprend celles de la découverte. La certification complète est obtenue après les deux modules. Des notes sont aussi attribuées pour chaque partie lorsque le Brevet est suivi dans le cadre d’une maquette de formation.
-
Le BrevetAI est-il obtenu après le niveau découverte ou après le niveau avancé ?
Le BrevetAI est une certification globale constituée de deux micro-certifications. Après le niveau Découverte, une première micro-certification est délivrée. Le niveau Avancé valide l’ensemble des compétences pour la certification complète.
Utilisation de l’IA, enjeux éthiques et réflexions critiques
-
Quelle est la place de l'IA pour "aider" à répondre aux quiz ? Comment certifier de façon certaine ?
L’utilisation d’une IA pour aider à répondre aux quiz est possible comme pour tout travail en autonomie. A noter que ces IA n’offrent pas toujours de résultats fiables. Concernant les activités interactives, nous avons testé les retours de plusieurs outils qui ont commis des erreurs. La certification ici combine quiz et activités pratiques pour mieux garantir les acquis. Aussi, au début de BrevetAI et en introduction de chaque partie, nous encourageons les étudiants à s’impliquer pleinement dans leur apprentissage : lire activement les fiches, expérimenter plusieurs fois les activités interactives et progresser à son rythme dans le but de favoriser un engagement actif et une envie d’apprendre sur ce type de sujet.
-
Est-ce que les enjeux éthiques de l’IA sont abordés dans le SPOC BrevetAI ?
Oui, dans le cours sur les enjeux sociétaux, il y a une partie sur les enjeux éthiques, notamment l’impact de l’IA sur le travail et les risques liés à son usage.
-
Le BrevetAI aborde-t-il les enjeux sociétaux, éthiques et écologiques liés à l’intelligence artificielle ? Y a-t-il une réflexion critique avec des chercheurs en SHS sur les dérives possibles de l’IA : poids écologique, dépendance aux GAFAM, etc. ?
Oui, ces enjeux sont pleinement intégrés, avec la contribution de chercheurs en sciences humaines et sociales (SHS). Le programme couvre :
o Impact écologique de l’IA ;
o Questions éthiques (biais, usages malveillants) ;
o Réglementations juridiques (les enjeux vis-à-vis des utilisateurs et les solutions légales existantes) ;
o Enjeux scientifiques (recherche en IA et reproductibilité).
Autres questions
-
Peut-on suivre les cours pour tester avant de décider de l'inclure dans une formation ?
Oui, nous pouvons vous inscrire au BrevetAI pour que vous le testiez sans qu’il n’y ait d’engagement de votre part.
-
Quel intérêt voyez-vous, par exemple pour des étudiant.e.s de niveau M2 en sciences, biologie… ? Comment présenteriez-vous cela aux étudiants pour justifier son inclusion ?
Aujourd’hui, l’IA est partout. Il est essentiel de démêler vrai et faux, comprendre ce qu’est l’intelligence artificielle et son fonctionnement. Le but est d’acculturer les étudiants pour développer leur esprit critique.
-
Comment se déroule l’inscription des étudiant(e)s ?
L’inscription se déroule via eCampus de la même manière que les autres SPOCs, soit :
- En inscrivant des cohortes ;
- En inscrivant via une liste d’étudiant(e)s ;
- Avec une clef d’auto-inscription (pour des publics étudiants qui ne sont pas associés à une formation/veulent passer le BrevetAI en autonomie). Un document détaillant ces modalités d’inscription sera disponible avant la rentrée. Vous pouvez également contacter le mail mentionné (inscription-brevetai@ens-paris-saclay.fr) en cas de question.
-
Comment se déroule la récupération des notes ?
Les notes du BrevetAI sont remontées dans le carnet de notes eCampus. Il vous suffira de choisir votre groupe et d’exporter les notes.
-
Vous proposez donc une base d’apprentissage Python, adaptable selon les formations, à condition qu’un enseignant-chercheur s’en empare en binôme avec votre équipe ?
Oui, exactement. L’idée n’est pas de proposer un cours figé, mais une collection de ressources pédagogiques modulables. Deux objectifs :
o Pérenniser la formation (car le financement d’enseignants par le SCube n’est pas durable à long terme).
o Adapter le contenu à chaque spécialité, avec un binôme incluant un enseignant du domaine pour contextualiser et cibler les besoins des étudiant.e.s.
-
Allez-vous créer des versions spécifiques selon les formations et spécialités ?
Pas automatiquement, mais vous pouvez tout à fait le faire. Les ressources sont pensées pour être appropriables et adaptables : chaque formation peut sélectionner les feuilles pédagogiques pertinentes, ajouter un projet disciplinaire, ou compléter avec d’autres contenus.
-
Le cours est-il adapté aussi bien pour des étudiants de licence que de master, dont les niveaux peuvent être très différents ?
Oui, le cours est conçu pour être générique. Il cible des étudiants sans expérience préalable en programmation, ou très limitée (ex. quelques notions vues en SNT ou ailleurs). Le critère principal est le niveau en programmation, pas l’année d’étude. Selon les formations, ce niveau peut se rencontrer en L1, L2, L3 ou même en master. À chaque responsable de formation de déterminer le moment le plus pertinent pour l’intégrer.
Exemples de modalités d’intégration possibles :
o En licence (par exemple L2 ou L3) comme UE obligatoire ou optionnelle ;
o En master, comme UE de remédiation pour les étudiants n’ayant pas acquis de bases en programmation ;
o En UE libre ou transversale, dans une formation comme les neurosciences.
-
Et au niveau des ECTS, est-ce flexible ?
Oui. Le format de base correspond à 1,5 à 2,5 ECTS, selon le volume de travail. Mais vous pouvez l’étoffer jusqu’à 4 ECTS en y intégrant un projet disciplinaire ou d’autres modules complémentaires. Le cours final apparaîtra simplement comme une « Introduction à la programmation Python », adaptée au contexte de chaque formation.
-
Quel format choisir ?
Le projet repose sur une base de matériel pédagogique modulable : il est réutilisable et ajustable selon le format souhaité (volume horaire, ECTS, projet disciplinaire, etc.). Il est recommandé de coordonner entre formations pour favoriser la portabilité (ex. : un étudiant change de parcours et a déjà suivi cette UE ailleurs).
-
Python pour toutes et tous se positionne comment par rapport à France-IOI ?
Il y a certainement une intersection et on cherche à collaborer. Nous essayons, dans un premier temps, de mutualiser à l'échelle de Paris-Saclay et au-delà. Nous avons conçu le matériel pédagogique pour qu’il soit en grande partie transversal et mutualisable entre disciplines. Mais pour favoriser l’engagement des étudiants, il est essentiel qu’ils perçoivent l’intérêt dans leur propre domaine.
C’est pourquoi nous encourageons fortement un travail en binôme avec des enseignants de chaque discipline, pour sélectionner les contenus les plus pertinents pour leur formation et contextualiser l’apprentissage à travers des projets, exemples ou exercices adaptés. L’objectif étant d’obtenir un équilibre entre contenu généraliste et ancrage disciplinaire, afin de maximiser l’impact pédagogique. Nous sommes ouverts à collaborer avec des collègues de tous horizons.
-
Qui contacter si nos identifiants ne permettent pas de se connecter à myDocker, sachant que se connecter à JupyterHub ne posait pas problème ?
mydocker-upsaclay-request@listes.centralesupelec.fr
-
Faut-il s'inscrire pour tester les sessions du mardi ?
Non, l’entrée est libre, sans inscription. Sur la page d'accueil, il y a maintenant une documentation assez large et les contacts pour de l'aide : https://mydocker.universite-paris-saclay.fr.
-
De façon plus générale, l'accès aux serveurs GPU de OVH est-il possible dans nos formations en dehors de l'activité DataCamp pour les étudiants de master en IA ?
Il peut être possible d'accéder à des GPU via myDocker. Il y a des questions de gestion des coûts, nous contacter.
-
Le Data Camp est-il une UE de type cours magistral, TP, ou projet ? Comment se déroule-t-il concrètement ?
Le Data Camp se déroule en deux phases et s’adresse généralement à des étudiants de niveau M1 ou M2. Une semaine intensive fin décembre, avec des cours et TP toute la journée, animés principalement par des membres de l’équipe Scikit-learn, axés sur les usages de la librairie. Puis, de janvier à mars, les étudiants choisissent et travaillent sur 4 à 5 challenges proposés sur la plateforme CodaBench.
-
Y a-t-il un accompagnement pendant la phase des challenges (janvier-mars) ?
Oui, il y a un suivi allégé : des rendus sont attendus à différents moments et permettent aux étudiants d’avoir des retours. En parallèle, la plateforme fournit un tableau de bord avec des indicateurs sur la performance de leurs méthodes.
Le tout tourne sur des machines virtuelles OVH pour manipuler de vraies données de grande taille, en environnement souverain.
-
Quel est le coût chargé d'un Professeur Attaché ? Plus largement, nous avons eu ce type de besoin pour des écoles thématiques ouvertes à l'extérieur.
L’enveloppe est aux alentours de 12 000€ brut chargé par an.
-
Est-ce que le statut de professeur attaché (PA) est l’équivalent d’un professeur associé à mi-temps (PAST) ?
Non, un PAST est à mi-temps en entreprise et ce sont d’autres types de contrats. Un PA se rapproche plus d’un statut de professeurs associés.
-
Les professeurs attachés peuvent-ils intervenir dans toutes les composantes de l’Université Paris-Saclay ?
Oui, ils le peuvent. L’Université Paris-Saclay inclut l’ensemble des établissements composantes et associés (au sens large).
Les contrats de professeur attaché sont portés par l’Université Paris-Saclay, mais comportent une clause de mobilité permettant d’intervenir dans toutes les entités, y compris CentraleSupélec, l’UVSQ, etc.
-
Pourquoi ne pas revaloriser les vacations selon le niveau d’expertise des enseignants ?
Ce n’est pas possible légalement. La rémunération des vacataires est strictement encadrée par la réglementation nationale : il n’est pas possible de moduler leur salaire en fonction du niveau ou du profil.
Cette limite a été souvent discutée pour éviter que des enseignants soient tentés par des cours mieux rémunérés dans d’autres établissements.
L’alternative mise en place est la création du statut de professeur attaché — différent de vacataire — qui permet une rémunération plus attractive et une meilleure intégration dans les équipes pédagogiques, avec participation à certaines tâches collectives.
-
Existe-t-il des UE ou enseignements permettant de se former à l’usage des outils d’IA, notamment dans une approche applicative (IA générative, outils spécialisés en santé, etc.) ?
Oui, plusieurs enseignements existent selon les usages. Sur l’IA générative (ex. ChatGPT), des réflexions nationales sont en cours, avec une charte à venir pour encadrer son usage pédagogique. Pour les outils spécialisés (comme en analyse d’images médicales), certaines UE sont déjà proposées, notamment dans des masters comme la bioinformatique, portées par des experts. Leur généralisation dépend toutefois des ressources et expertises disponibles.
-
Peut-on mutualiser ces formations autour de l’IA pour éviter que chaque master travaille en silo ?
C’est un enjeu important. Ces webinaires visent aussi à identifier des besoins communs pour envisager des mutualisations. Les ressources présentées (comme les SPOC) sont mutualisables.
En revanche, pour les usages très disciplinaires, les contenus doivent être adaptés, car les outils et contextes diffèrent fortement selon les domaines (santé, astronomie, etc.).
-
Comment faire face à l’impossibilité de distinguer le travail d’un étudiant de celui d’une IA générative ? Peut-on encore évaluer de manière juste et équitable ?
C’est une préoccupation largement partagée. Il devient difficile d’identifier de façon fiable le recours à l’IA dans les devoirs à distance. Au niveau universitaire, plusieurs actions sont en cours :
o Une charte sur l’usage de l’IA générative, bientôt diffusée, pour encadrer les pratiques et fixer des repères clairs ;
o Un portfolio de bonnes pratiques pour sensibiliser aux usages responsables, en tenant compte aussi des impacts environnementaux ;
o Des formations pour enseignants afin d’intégrer ces outils de manière éthique et pédagogique ;
o Des outils de détection, basés sur l’analyse lexicale, bien que limités car les étudiants adaptent leurs méthodes.
L’université travaille aussi à développer des solutions souveraines pour mieux contrôler les données et éviter une dépendance aux plateformes commerciales. Le message clé : il ne s’agit pas de bannir l’IA, mais de construire collectivement un cadre pédagogique et éthique clair pour un usage responsable et transparent.